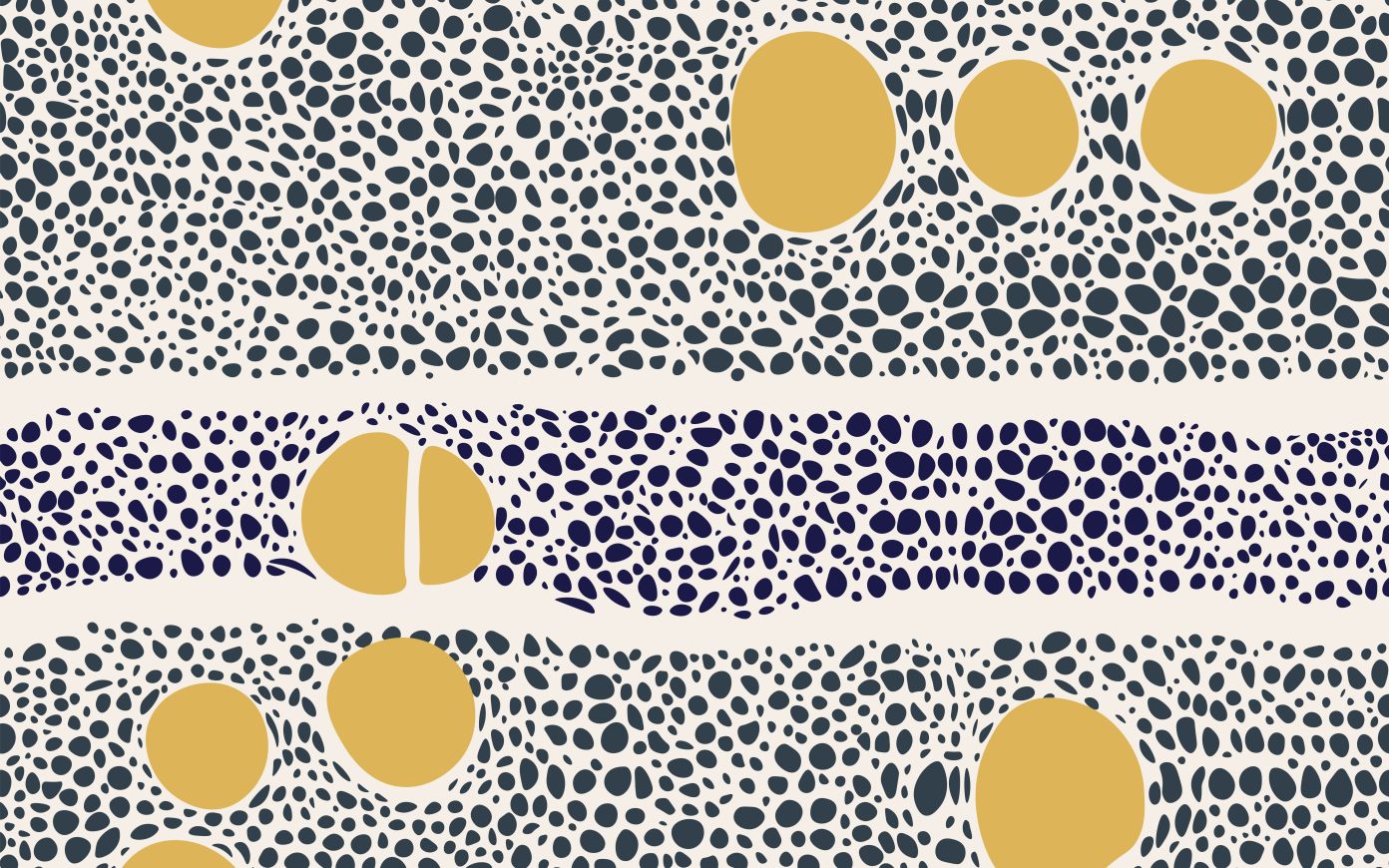Vous avez étudié la construction du récit écologique en architecture. Pourriez-vous nous brosser rapidement le contexte d’une telle émergence ?
J’emprunte le terme « récit » à Jean-François Lyotard, qui l’identifie en 1979 dans La Condition postmoderne. Il y définit le « récit » comme le discours qu’une culture donnée se raconte à elle-même au sujet de ses propres croyances. Dans cette lignée, j’ai essayé de comprendre la manière dont la prise de conscience écologique dans le milieu architectural des années 1990 pouvait être lue comme l’émergence d’un nouveau récit pour celui-ci.
Certains milieux marginaux – notamment la contre-culture américaine – laissent entrevoir une considération pour l’écologie dès les années 1960. Plusieurs organisations non gouvernementales – à l’image des communautés hippies ou de « Drop city » Village du Colorado ayant accueilli la première communauté hippie rurale, entre 1965 et 1970.– se penchent sur le réemploi, l’énergie ou le nomadisme. Le Sommet de la Terre à Stockholm, en 1972, puis le choc pétrolier de 1973 viendront encore alimenter ces questionnementsSur cette période, la lecture de l’ouvrage de Caroline Maniaque, Go West. Des architectes aux pays de la contre-culture, publié en 2013 aux éditions Parenthèses, apporte un éclairage pertinent. Voir aussi l’ouvrage de Fanny Lopez Le rêve d’une déconnexion. De la maison autonome à la cité auto-énergétique, publié aux éditions de la Villette en 2014.. Il faut néanmoins attendre la fin des années 1980 pour que ces questions soient fortement médiatisées, institutionnalisées et qu’elles gagnent en légitimité. La création du GIECGroupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, organisation mise en place en 1988, à la demande du G7. – suivie de la constitution de la Charte Européenne de l’Environnement et de la Santé puis du Sommet de la Terre de Rio – engendrera une médiatisation sans précédent. Ces problématiques quittent finalement les milieux marginaux pour s’immiscer dans le secteur du bâtiment avec la signature du protocole de Kyoto et ses injonctions concernant le secteur énergétique. L’écologie s’institutionnalise ainsi au travers du prisme de l’énergie avant de s’ouvrir à d’autres champs, dont les architectes se sont emparés depuis les années 1990.
L’élément déclencheur est probablement le climat eschatologique, cette atmosphère de fin des temps, qui a suivi les catastrophes de BhopalCatastrophe industrielle majeure, ayant eu lieu en Inde en 1984 et de Tchernobyl, mais aussi la fin de l’euphorie du postmodernisme, qui prônait de danser sur les décombres de la modernité mais de danser tout de même. Le slogan punk « no futur » prend vraiment sens à la fin des années 1980. Au même moment, la parution d’ouvrages comme Les Trois écologies de Felix Guattari, Le Contrat naturel de Michel Serres, Nous n’avons jamais été modernes de Bruno Latour ou Le Nouvel ordre écologique de Luc Ferry s’emparent de la question environnementale pour en proposer des lectures très différentes, qui engageront le débat. L’opinion publique s’alerte, et certains architectes pionniers comme Jourda-Perraudin, Lacaton et Vassal, Edouard François ou Philippe Rahm – pour ne citer que les Français – s’emparent de cette question. C’est dans ce contexte général de chaos et de préoccupation énergétique plus forte chez les constructeurs – poussés par les intellectuels et quelques figures pionnières –, que le récit écologique prend forme dans le milieu architectural.
De quoi ce « récit » est-il le nom ?
Je me suis rendu compte que le récit écologiste était une manière de lire l’Anthropocène, qu’il me permettait de proposer une vision plus ample de ce que certains appelaient la crise écologique ou la transition énergétique. Dans la mesure où la thèse Anthropocène n’est pas centrée sur la seule question énergétique, elle fait passer d’un temps de crise – surmontable par des outils techniques – au temps long de la géologie. Le thème du récit écologiste prend tout à coup une autre dimension à cette aune.
Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste FressozAuteurs de L’Évènement Anthropocène, Paris, 2013, Seuil. Cet ouvrage propose une déconstruction du terme Anthropocène en tant que « période géologique durant laquelle l’espèce humaine serait devenue une force tellurique », pour proposer de le définir comme le « récit » construit par les techniciens et les ingénieurs des questions environnementales pour légitimer de nouveaux types d’actions, notamment la géo-ingénierie. distinguent deux lectures antagonistes de l’Anthropocène : une acception qui servirait la géo-ingénierie – confirmant notre force et notre pouvoir, puisant encore et toujours des solutions dans le Progrès, notamment technique –, opposée à l’idée d’une société de la décroissance remettant en question l’aporie de la modernité, valorisant des comportements appropriés aux bouleversements engagés. Cette vision propose un mode de production et de vie plus alternatif, à l’inverse de la question énergétique, qui nous maintient dans une posture très moderne en proposant de trouver les outils pour continuer à vivre comme on le faisait.
Le récit écologiste, comme l’Anthropocène, place l’homme dans la position délicate d’être à la fois victime, pécheur et en position d’acteur en quête d’une société plus vertueuse. La responsabilité de l’homme dans l’évolution de la planète est devenue indéniable ; appeler cette période Anthropocène – l’ère de l’homme –, suscite en revanche de nombreuses questions. Selon une vision marxiste, Bonneuil et Fressoz proposent le concept de Capitalocène, tandis que j’aurais plutôt tendance à parler Modernocène, puisque ce sont bien les valeurs de la modernité qui ont mené à la dissociation de notre rapport au vivant, au milieu et à la nature.
Comment cela s’exprime-t-il dans les projets architecturaux ? De nouvelles relations au vivant s’y révèlent-elles ?
Avant l’apparition tonitruante du durable dans l’architecture – au mi-temps des années 2000 – il y a déjà des exemples manifestes de projets porteurs d’un questionnement écologique fort. En 1998, Lacaton et Vassal dessinent au Cap Ferret une maison extrêmement respectueuse de l’environnement dunaire sur lequel elle se greffe. Les pilotis qui la maintiennent permettent au sable de se déplacer librement au dessous, laissant le paysage conserver sa dynamique écologique. La présence de l’habitation n’endommage pas non plus la pinède, puisque l’architecture se déploie autour sans qu’aucun arbre n’ait été abattu. Les troncs traversent les parois, émergent du plancher des pièces à vivre, deviennent des éléments du quotidien avec lesquels les habitants entretiennent une relation étroite. Il est évident que le fait d’habiter un tel lieu invite à considérer autrement les « objets » qui composent l’environnement.
Dans le projet de réhabilitation de la tour Bois-le-Prêtre, également de Lacaton et Vassal, avec Frédérique Druot, il est davantage question de « milieuCf. entretien avec Augustin Berque », et plus précisément de celui d’un patrimoine dit « peu remarquable ». Ce projet considère « ce qui existe », c’est-à-dire non plus la dune du Cap Ferret mais un immeuble conçu à la fin des années 1950. Composer avec l’existant et laisser apparaître certains éléments de l’ancienne architecture permet à la nouvelle enveloppe de conserver la mémoire des lieux. L’immeuble se transforme plus qu’il n’est remplacé. Ce projet ne renvoie pas directement au vivant, mais le fait d’apprendre à vivre avec un bâtiment chargé d’un imaginaire assez lourd est une façon de s’inscrire dans un récit de l’Anthropocène. Il s’agit d’apprendre à considérer son environnement avec bienveillance, quel qu’il soit, et trouver les outils pour l’appréhender d’une manière plus heureuse.
À Nantes, le Lieu Unique – transformation d’une ancienne biscuiterie en centre culturel par Patrick Bouchain –, est également un bon exemple. Plutôt que d’envoyer des barils ayant servi au stockage de produits toxiques en Afrique – ils devaient y servir de matériau de construction pour une école –, Patrick Bouchain a décidé d’utiliser cette « ressource locale » dans son projet. Il dénonce ainsi l’envoi de déchets en Afrique et nous confronte à notre propre système de production, nous poussant à assumer nos responsabilités environnementales. « Il faut apprendre à vivre avec Frankenstein » disait Bruno Latour, proposant de trouver le cadre et les conditions nous permettant de vivre avec nos « monstres », non plus culturels ou naturels mais hybrides.
Pour les architectes, l’enjeu est de trouver des modalités de bienveillance permettant d’engager des liens entre les habitants et leur milieu – le milieu « naturel » mais aussi les milieux anthropisés et dégradés –, de manière à assumer une certaine forme de mémoire et de responsabilité. Il s’agit également de multiplier les paramètres, de donner une voix à ce qui reste traditionnellement muet, le vent ou les abeilles par exemple, en allant jusqu’à avoir de la considération pour l’existence d’architectures médiocres.
La reconnaissance du doute et de l’incertitude face à l’imprévisibilité des éléments participe-t-elle à un renouveau du caractère sacré de l’environnement ? Comment l’architecture pourrait-elle témoigner de ce changement de rapport au monde ?
La chapelle de Bruder KlausBruder Klaus Chapel, située à Saint-Nicolas-de-Flue, près du village de Wachendorf, aux environs de Cologne et inaugurée en 2007 – conçue par Peter Zumthor – est assez représentative de la manière dont les architectes peuvent engager une forme de sacralité dans une architecture de l’Anthropocène. Zumthor fait monter une armature de bois, coule du béton autour puis le brûle, interrogeant et dérangeant le public à la fois en façonnant un espace par un matériau dont on voit les traces, que l’on sent et qui en même temps est absent. Il pose ainsi la question du milieu, de la matière et de sa disparition, engageant une certaine sacralité. Les projets qui développent cette dimension me semblent davantage réussir à dépasser l’approche strictement terre à terre des questions environnementales. En aménageant le port de Zadar, Nikola Basic a par exemple traité l’emmarchement des quais de façon à ce qu’il accueille un orgue de mer, dispositif souterrain de tubes qui émet des sons en surface au rythme des vagues. L’hybridation des éléments naturels et du bâti y façonne une atmosphère très particulière, qui se rapproche du sacré et incarne un dialogue entre nature et culture. L’espace public y devient pièce de théâtre et concert, tout en suscitant une prise de conscience de l’environnement. L’architecte doit réfléchir à ces modalités de rencontre entre le public, les éléments naturels et l’existant au sens le plus large, le vivant comme l’architecture transformée.
Ces architectures de l’Anthopocène vous semblent-elles modifier notre rapport au temps ?
La transition énergétique est liée à l’idée de crise, et par définition à une temporalité relativement courte. Elle est surmontable et appelle l’idée d’après-crise. L’Anthropocène renvoie en revanche à une période géologique étalée sur une durée presque incommensurable à l’échelle de la vie de l’homme et de la femme, et de plus en plus discutée, puisque certains la feraient remonter à la découverte de l’Amérique. En plus de nous projeter dans un temps plus long en arrière, cela nous projette dans un temps plus long à venir, à l’échelle des éléments. Avec l’émergence des questions écologiques, de nombreux projets se sont mis à revendiquer une empreinte plus légère au niveau énergétique. Le durable n’a donc pas nécessairement engendré une architecture plus pérenne, de nombreuses réponses se revendiquant au contraire éphémères, ce qui peut sembler paradoxal. En réalité, l’apparition des préoccupations autour du recyclage a pérennisé cette idée d’éphémère en réintroduisant les matériaux dans différents cycles de vie successifs. La question du réemploi a notamment émergé via l’exposition Matière grise du Pavillon de l’Arsenal. Des objets qui nous semblaient obsolètes se découvrent une 2e, 3e ou 4e vie, ce qui nous interroge sur le temps des bâtiments. La tour Bois-le-Prêtre est-elle tout à fait la même qu’en 1959, lorsque Raymond Lopez l’a dessinée ? Elle a de fait subi plusieurs transformations, d’abord dans les années 1990 par le bureau d’études techniques Tecteam, puis dans les années 2000 avec les architectes Lacaton, Vassal et Druot, mais elle conserve certains traits qui la caractérisent. Le processus de transformation nous interroge tant sur la temporalité de l’architecture que sur la capacité de « ce qui reste » du projet à en porter ses caractéristiques essentielles.
En 2016-2017, les étudiants de l’ENSA Paris-Malaquais ont travaillé sous ma direction à la conception d’un monument de l’Anthropocène, en écho à l’exposition « Anthropocène Monument » qu’avait monté Bruno Latour en 2014 aux Abattoirs de Toulouse. Ils ont défini au cours du semestre les conditions d’une architecture de l’Anthropocène : des concepts qu’elle porte à sa matérialité en passant par sa temporalité ou par le rapport qu’elle engage au milieu dans lequel elle se trouve. Les projets posaient des questions pertinentes et montraient l’intérêt d’une jeune génération pour ce sujet. C’est encourageant.
Cet article a été initalement publié en novembre 2017 dans la revue Stream 04.
Commander la revue