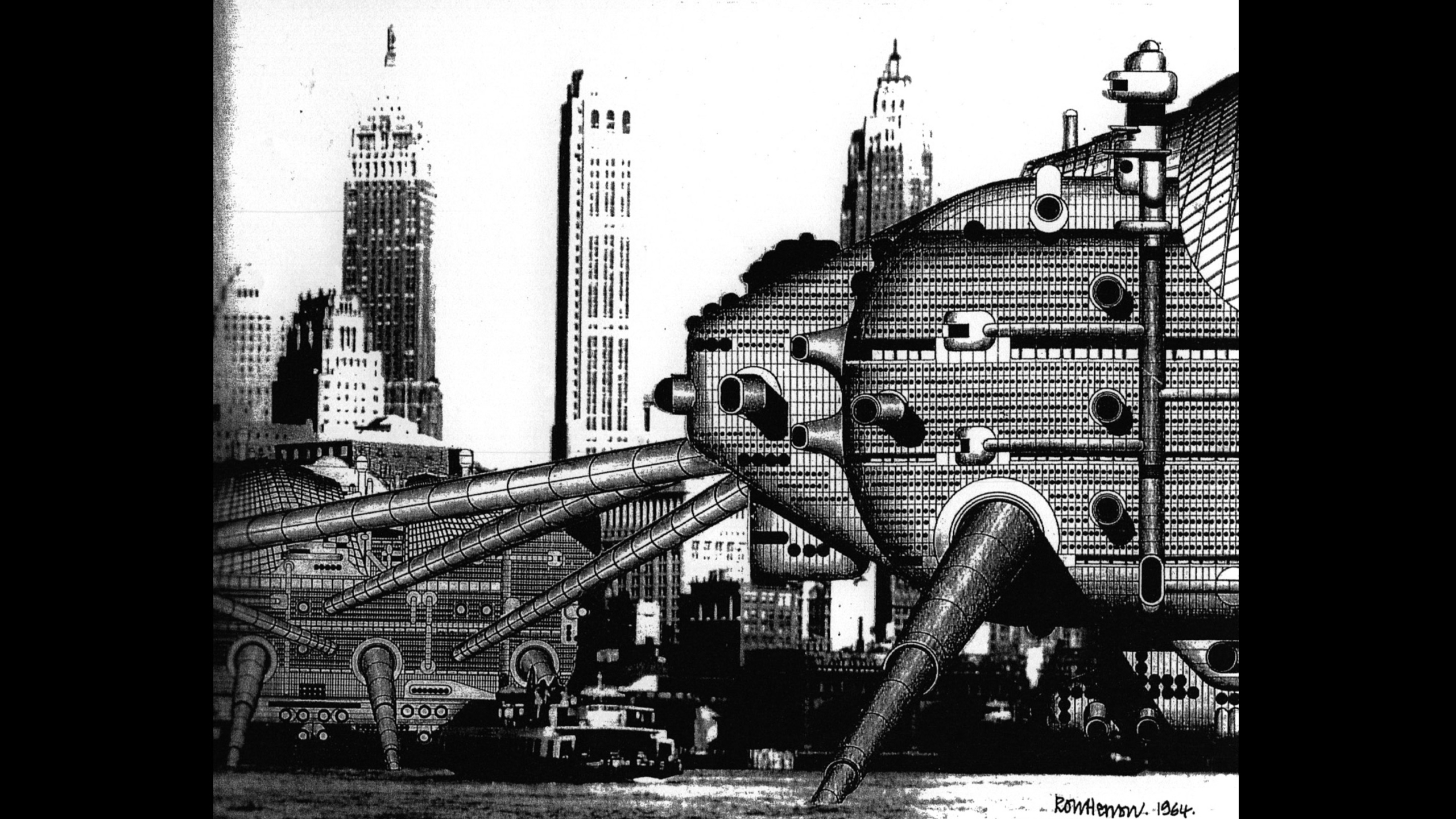La nécessaire redéfinition de la chaîne logistique
Les transformations radicales des méthodes de travail ainsi que les nouveaux modes de vie, à cause de l’émergence de l’économie du savoir, ont pour conséquence que les bureaux, en tant que type architectural mais aussi comme part entière de l’urbanisme, sont devenus obsolètes et ont urgemment besoin d’être repensés. En fait, on se serait attendu à ce que les employés de bureaux, les architectes et la communauté de l’immobilier aient déjà trouvé une réponse au défi lancé par ces mutations. Pourquoi l’innovation est-elle si pressante et pourtant si difficile à rencontrer ?
La réponse réside peut-être dans la nature particulièrement réfractaire et fragmentée de la pratique de l’immobilier de bureaux, surtout dans un monde de promoteurs anglophones. Après avoir tenté pendant des années de tisser des liens entre les utilisateurs d’espaces de bureaux, les promoteurs et les agents immobiliers, ma conclusion personnelle est que le rapport entre l’offre et la demande a été (et continue) d’être extrêmement déformé par l’accent mis sur les affaires et les transactions, plutôt que fondé sur des considérations à long terme, telles que l’utilisation de l’espace dans le temps, l’impact que le bureau peut avoir sur ses utilisateurs ou la performance des entreprises – autrement dit une réflexion sur la fonction de l’espace.
Au lieu de cela, nous sommes face à une chaîne logistique qui commence par un apport pécunier, disons à Abu Dhabi, passe par un promoteur à Londres, par exemple, qui engage des avocats, puis des programmateurs, et ensuite des architectes et une équipe de design pour enfin revenir aux mains de constructeurs. Pendant ce temps, des agents immobiliers cherchent à démarcher les départements immobilier d’entreprises qui, l’affaire réglée, s’en remettent à des gestionnaires d’installations – qui ont sûrement peur des utilisateurs. L’aménagement de l’espace et l’architecture d’intérieur sont souvent conçus selon des programmes qui ne sont pas forcément liés aux intérêts premiers des clients. En d’autres termes, les chaînes existantes pour le développement des bureaux, leur conception et la gestion des équipements sont à sens unique, hachées, intéressées, imparables et surtout – c’est là le pire – sans feedback.
Il n’est donc pas étonnant qu’autant d’immeubles de bureaux soient dysfonctionnels. Le système de livraison dont nous avons hérité et que nous tenons pour acquis ne peut, dans sa forme actuelle, se réparer. La solution est simple : en réintroduisant intelligence, réponses adaptées et feedback dans l’offre et la livraison des immeubles de bureaux, les douze hypothèses listées ci-dessus pourraient se réaliser. Ainsi, nous n’aurions pas seulement des immeubles de bureaux, mais des villes du XXIe dont l’économie du savoir a tant besoin, et qu’elle mérite.
Traduit de l’anglais par Colette Taylor-Jones
(Cet article a été publié dans Stream 02 en 2012.)