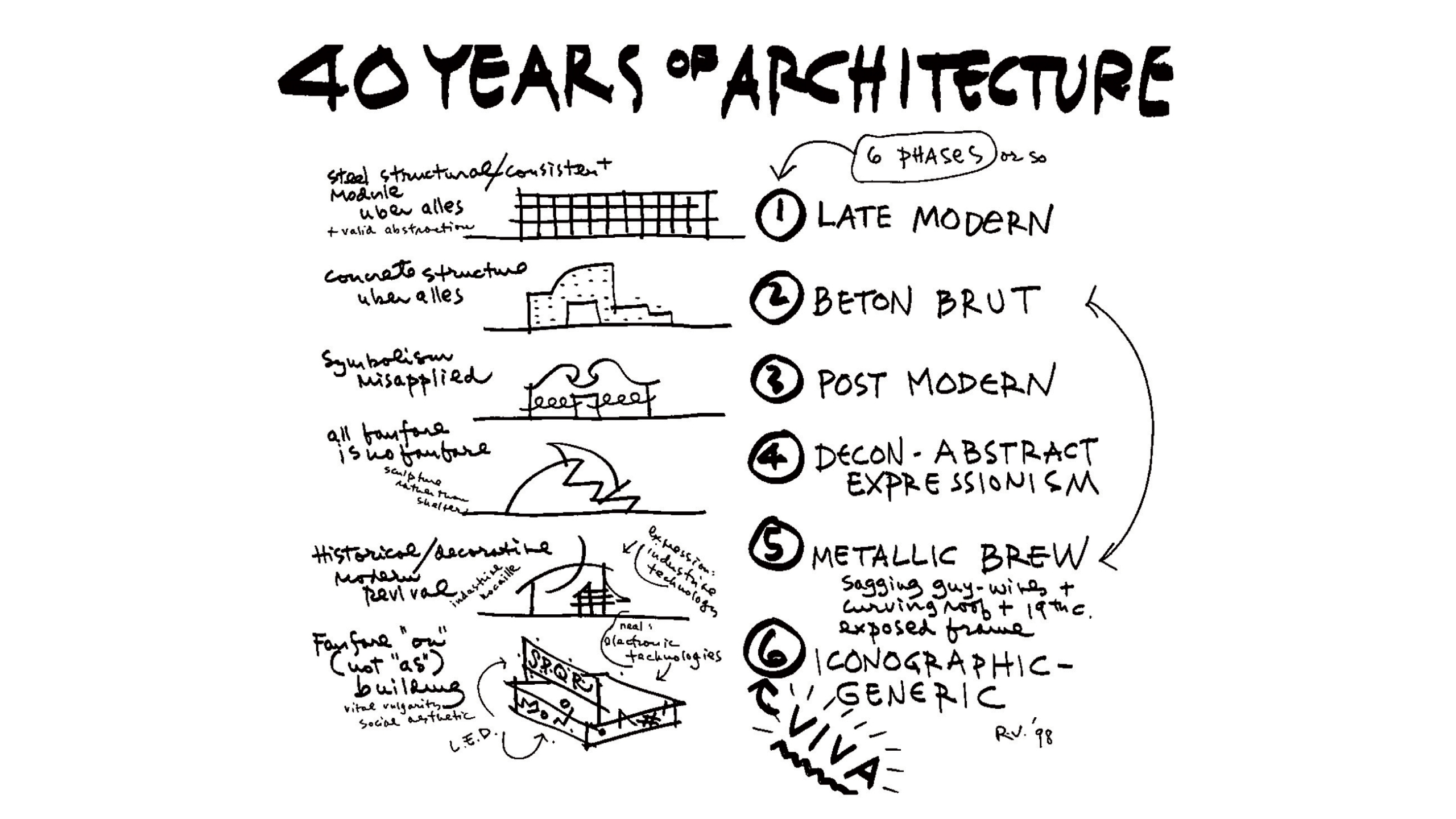On peut citer dans ce contexte la Kunsthaus de Graz, par Peter Cook et, plus récemment, le concours remporté par Zaha Hadid pour le musée d’art moderne de Cagliari, de mon point de vue le projet tout à la fois le plus amorphe et le plus extravagant de cette architecte, projet qui n’a certainement aucune chance de voir le jour sous cette forme. C’est aux Etats-Unis que l’on peut observer le marketing urbain dans ce qu’il a de pire : de petites villes se découvrent soudain des collections d’art dont on ignorait tout, mais surtout de riches donateurs grâce auxquels elles s’offrent la « signature » muséale d’un membre de la famille des grands architectes. Les exemples de ces musées axés sur le marché sont déjà si nombreux et il est si captivant d’enquêter sur eux, qu’ils mériteraient un article à part entière. Après le musée d’Atlanta, Renzo Piano a immédiatement obtenu plusieurs commandes du même type aux Etats-Unis. À cela s’ajoutent un Steven Holl à Kansas City, un Santiago Calatrava à Milwaukee, un Daniel Libeskind à Denver, un Rem Koolhaas à Las Vegas, et ainsi de suite.
Cette évolution avait pourtant connu des débuts intéressants, comme le montre le cas de Melsungen, une petite ville allemande du nord de la Hesse. Il y a quatorze ans, James Stirling y construisit la plus grande usine européenne d’instruments médicaux – seringues, cathéters, canules, une installation de pied en cap. L’entreprise affichait sa volonté de tracer une nouvelle voie avec un dispositif dont les idées conceptuelles et formelles ont conservé toute leur valeur. En dépit de la grande singularité du langage architectural de Stirling, la direction de l’entreprise avait renoncé à toute emphase gestuelle. On se contenta de repenser sobrement le thème de l’usine pour réaliser un ouvrage durable. On peut ici citer un tout autre exemple, la tour de 260 mètres de haut de la Commerzbank à Francfort, due à Lord Norman Foster, témoignant d’une nouvelle conception de la tour. Les exigences d’une construction écologique sont prises en compte, notamment sur les façades, par l’utilisation d’énergies renouvelables, capteurs solaires et éoliennes.
L’immeuble prévu également à Francfort pour la Banque centrale européenne par Coop Himmelb(l)au, une tour à double pan sur un corps de bâtiment horizontal, n’est au contraire, en dépit de la virtuosité technique dont elle témoigne, qu’un gag formel de réalisation complexe. Les trois tours de bureaux prévues sur le site de l’ancienne foire de Milan sont également des formes contraintes. Celle d’Arata Isozaki est soutenue par des renforts en diagonale qui ne réussissent qu’à lui donner un aspect absurde, celle de Daniel Libeskind semble se recroqueviller de laideur et celle de Zaha Hadid pivote sur son propre axe avec un socle en zigzag. De tels édifices n’ont aucun sens en termes de construction et ne sont composés que par additions.
Chacun de ces projets ne renvoie qu’à lui-même et se décompose en unités architectoniques sans cohérence. Aucune de ces stars ne semble s’être réellement préoccupée de la signification revêtue par cette zone pour la ville de Milan. Ce projet de vie urbaine sans conception d’ensemble identifiable ne s’explique, avec un investissement de 1,5 milliards d’euros, que par la stratégie de marketing de la Société des foires de Milan. Le projet est vendu par des déclarations comme celle de Daniel Libeskind au Corriere della
Serra en 2004 : « Notre projet est né de l’idée qu’à la différence du précédent,
le XXIe siècle est déterminé par l’idée directrice non de l’individu, mais de la multiplicité : le temps est passé où il n’y avait qu’une pensée directrice, un unique point de référence et une unique possibilité de réussite. Le XXIe siècle se révélera au contraire comme une société ouverte, organisée démocratiquement et dont les présupposés pluralistes correspondent à la richesse culturelle du quotidien de la vie d’aujourd’hui. »