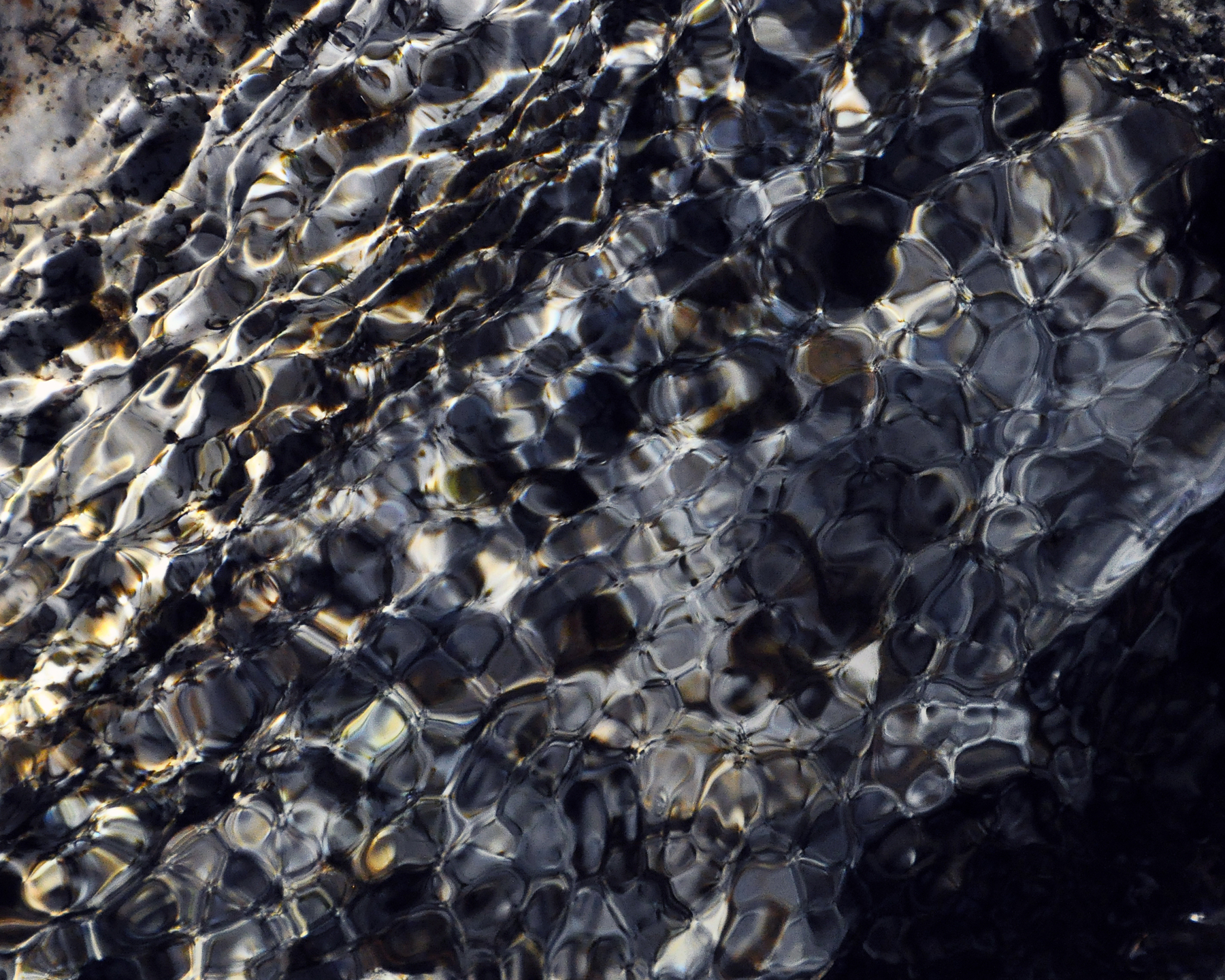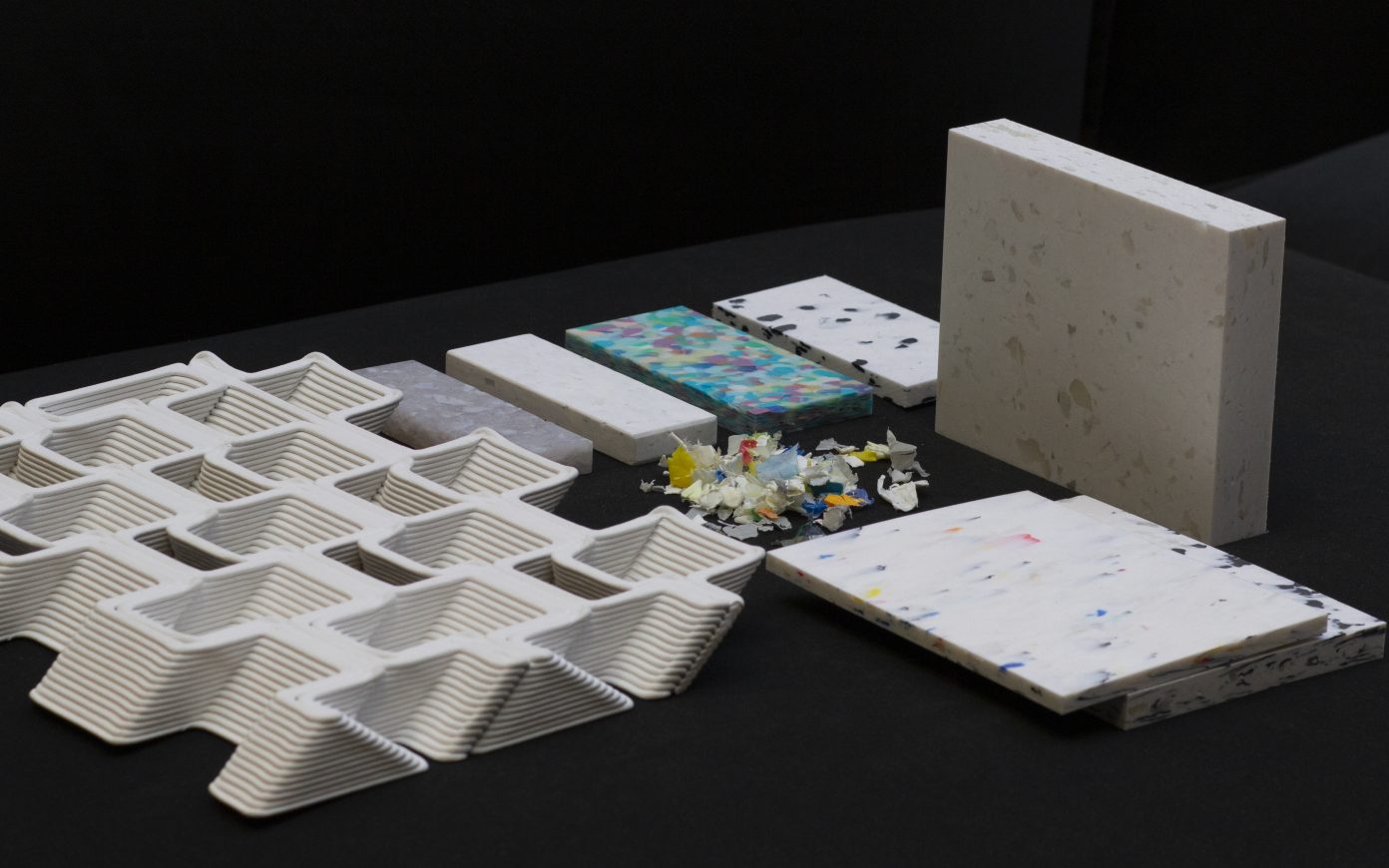Considérer le « vivant » au XXIe siècle exige de repenser les rapports sujet/objet et culture/nature, mais aussi que nous nous posions de nouvelles questions : l’humanité s’engagera-t-elle dans la voie de la géo-ingénierie ? Trouverons-nous une relation équilibrée avec l’environnement ? Quels engagements politiques devrions-nous avoir en tant qu’architectes ? Quels outils philosophiques et technologiques pourraient rendre effectif cet engagement ? L’Ontologie Orientée Objet fournit-elle un cadre pour aborder ces différentes interrogations ?
L’Ontologie Orientée Objet (OOO) désigne par « objet » l’unité fondamentale du réel. Nous entendons ainsi la notion d’« objet » de manière beaucoup plus large qu’appliquée aux seules choses concrètes et matérielles. Un objet, pour l’OOO, est tout simplement ce qui ne peut être réduit de façon exhaustive, que ce soit par le haut ou par le bas : tout ce qui n’est pas réductible à ses composants ou ses effets. Toute forme de connaissance fait l’une de ces deux choses. Remarquez qu’il n’y véritablement que deux formes de connaissance : nous pouvons dire de quoi quelque chose est fait et ce que fait cette chose, avec toutes les variations possibles entre ces deux options. C’est ce que j’appelle undermining et overmining, qui pourrait être exprimé en français par « démolition » et « ensevelissement »C’est la solution que propose Olivier Dubouclez dans L’Objet quadruple : Une métaphysique des choses après Heidegger (Presses Universitaires de France, Paris, 2015), seule traduction d’un ouvrage de Graham Harman en français à ce jour. Il explique que « la précision conceptuelle et la transparence lexicale des termes originaux » ne peut être égalée mais que « l’opposition introduite par l’auteur » peut néanmoins être rendue par les notions de « démolition », c’est-à-dire la « [décomposition] […] d’une masse […] en éléments […] plus petit[s], et d’« ensevelissement », c’est-à-dire son « écrasement […] sous une masse de déterminations qui lui sont étrangères ».. La « démolition » (undermining) avance qu’une chose peut être paraphrasée au moyen de ses composants. L’« ensevelissement » (overmining) correspond à une tentative de paraphraser un objet en fonction de ce qu’il fait, de ce qu’il nous montre directement, des « événements » auxquels il participe, de ses effets relationnels. Quand les gens brandissent l’étendard deleuzien, affirmant qu’ils sont davantage intéressés par ce qu’une chose peut faire que par ce qu’elle est, il s’agit donc seulement d’une forme de réductionnisme qui est l’inverse du type habituel. Cela revient à réduire par le haut plutôt que par le bas. Ce à quoi nous devons parvenir, c’est à l’objet qui existe entre ses composants et ses effets. C’est ce que j’appelle la « troisième table » : il ne s’agit ni des pièces d’une table, ni de ses effets pratiques, mais de la table elle-même.
Je pense que les arts abordent mieux cette question que la philosophie, car ils sont parfaitement conscients de ne pas foncièrement constituer une forme de connaissance. La philosophie non plus, mais beaucoup de philosophes se sont néanmoins persuadés du contraire. L’art et la philosophie sont des disciplines cognitives, mais la connaissance n’est pas la seule forme de cognition qui soit. La connaissance est à l’évidence quelque chose de très important – toute notre civilisation moderne est fondée sur la connaissance. Nous avons tant de connaissances que nous ne savons même plus quoi en faire. Et pourtant, la connaissance n’est pas la seule forme de cognition qui vaille la peine qu’on s’y intéresse.
Socrate nous a appris que la philosophie n’était pas une forme de la connaissance. L’une des leçons des dialogues de Platon est que nous n’obtenons jamais vraiment la définition de quoi que ce soit. Socrate ne fait que demander ce qu’est la vertu, l’amour, l’amitié, la justice, mais il ne donne jamais de réponse. Il démolit les réponses des autres mais n’aboutit jamais lui-même à une réponse. Il nous dit que seul un dieu peut avoir cette connaissance. Le mot philosophie lui-même, philosophia, signifie l’amour de la sagesse. Il ne s’agit pas ipso facto de sagesse, mais de quelque chose qu’on ne pourra jamais atteindre.
Les critiques de ce modèle disent souvent que l’on aboutit alors qu’à une théologie négative, que l’on dit juste ce que les objets ne sont pas, plutôt que ce qu’ils sont. Mais cela part du principe d’un résultat en « tout ou rien », qui voudrait que si l’on ne formule pas explicitement une connaissance discursive en propositions textuelles, alors ce ne sont que de vagues gesticulations mystiques. Ce n’est pas le cas. Les êtres humains ont énormément de connaissances métaphoriques, de l’ordre de l’évocation des choses plutôt que de leur description exacte. Allusions, sous-entendus, menaces… ces actes de langage ne constituent pas des paraphrases littérales de ce qu’est la chose, mais laissent entrevoir les objets. Il en est de même dans les arts : si l’on peut réduire une œuvre à un texte en prose, il s’agit vraisemblablement d’une œuvre médiocre ou d’un mauvais résumé. C’est l’un ou l’autre.
Nous savons qu’il n’y aura jamais d’analyse définitive de Hamlet ou de la poésie de Baudelaire, parce que ces objets ne peuvent être paraphrasés. En revanche, les sciences naturelles sont véritablement caractérisées par la paraphrase, à l’exception de quelques moments de crise scientifique. Si l’on prend un concept comme celui d’électron, le travail du scientifique est de découvrir de nouvelles caractéristiques des électrons. Tout l’inverse de ce qui se fait dans les arts et la philosophie.
L’OOO est une manière de traiter cette question en termes philosophiques. Les gens disent souvent que se concentrer sur ce qui échappe au langage discursif n’a rien de nouveau, du fait de la « chose en soi » de Kant ou de tel ou tel autre précurseur. Le problème, c’est que même chez Kant, la « chose en soi » est là, et c’est quelque chose que nous ne pourrons jamais connaître. Nous pouvons la penser, mais nous ne la connaîtrons jamais – tragique fardeau des hommes. L’OOO revendique une position plus radicale, estimant que dans toute interaction causale il y a un résidu ou surplus inexprimé. L’OOO observe comment cela fonctionne à différents niveaux, y compris au niveau de l’inanimé.