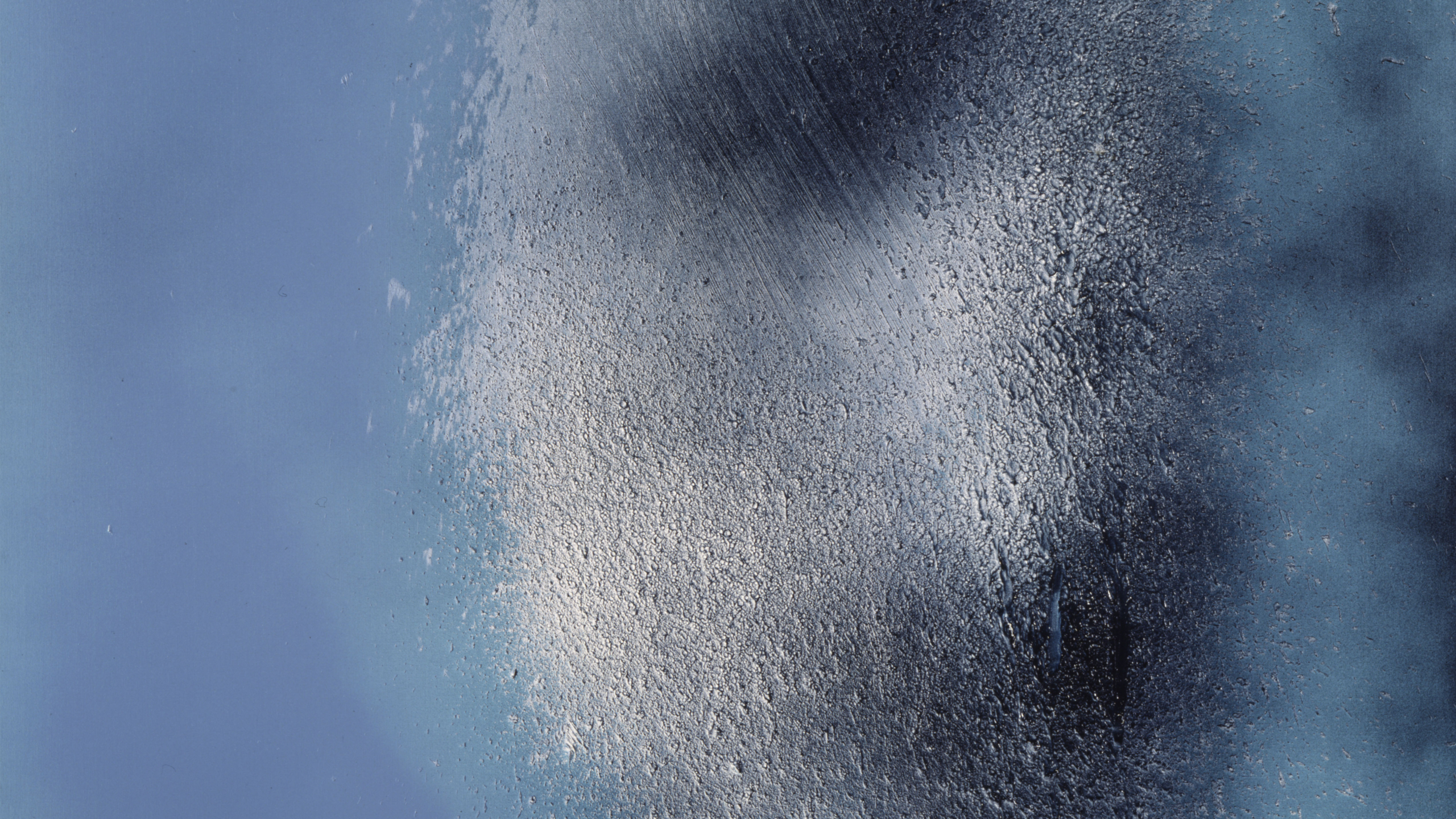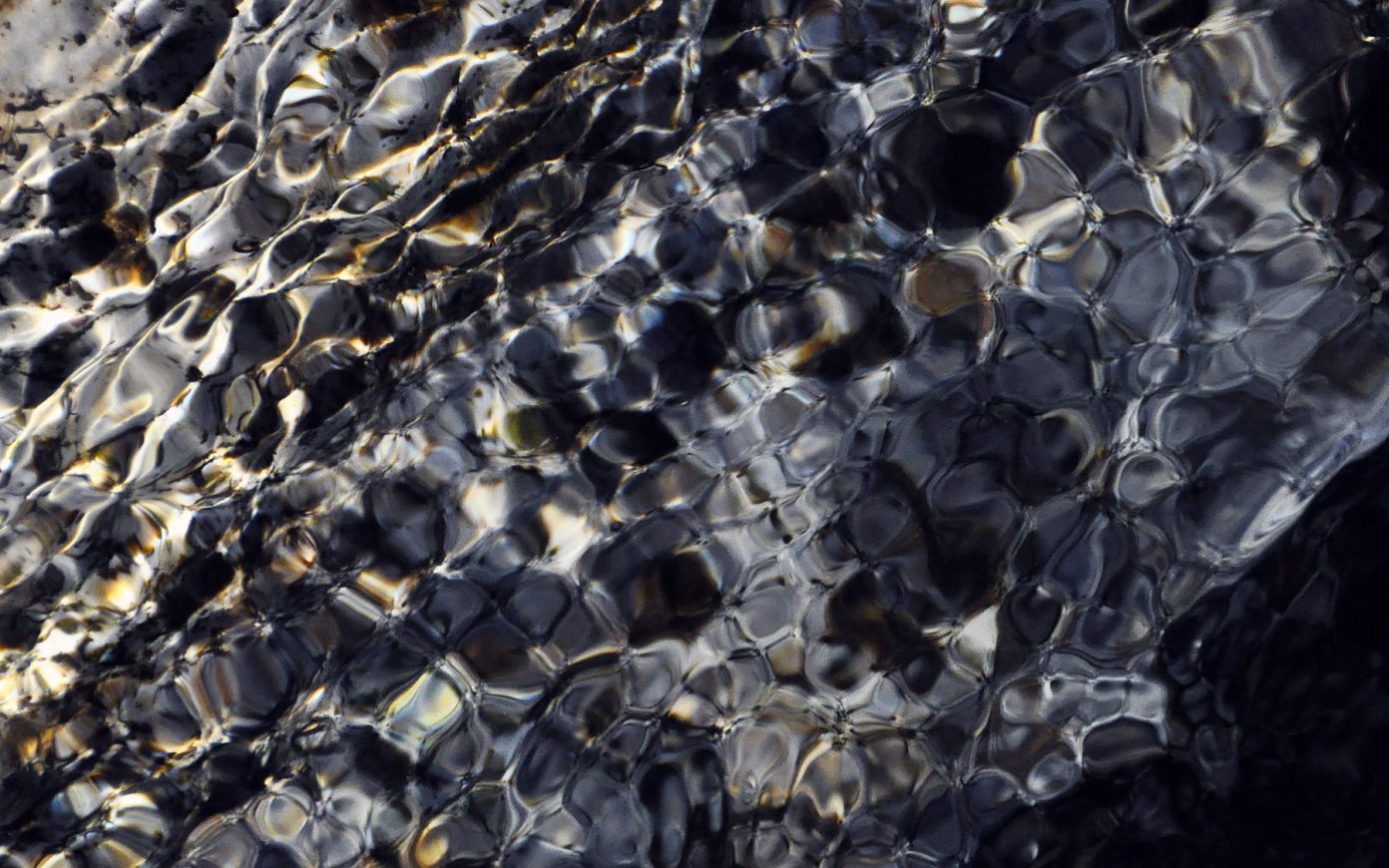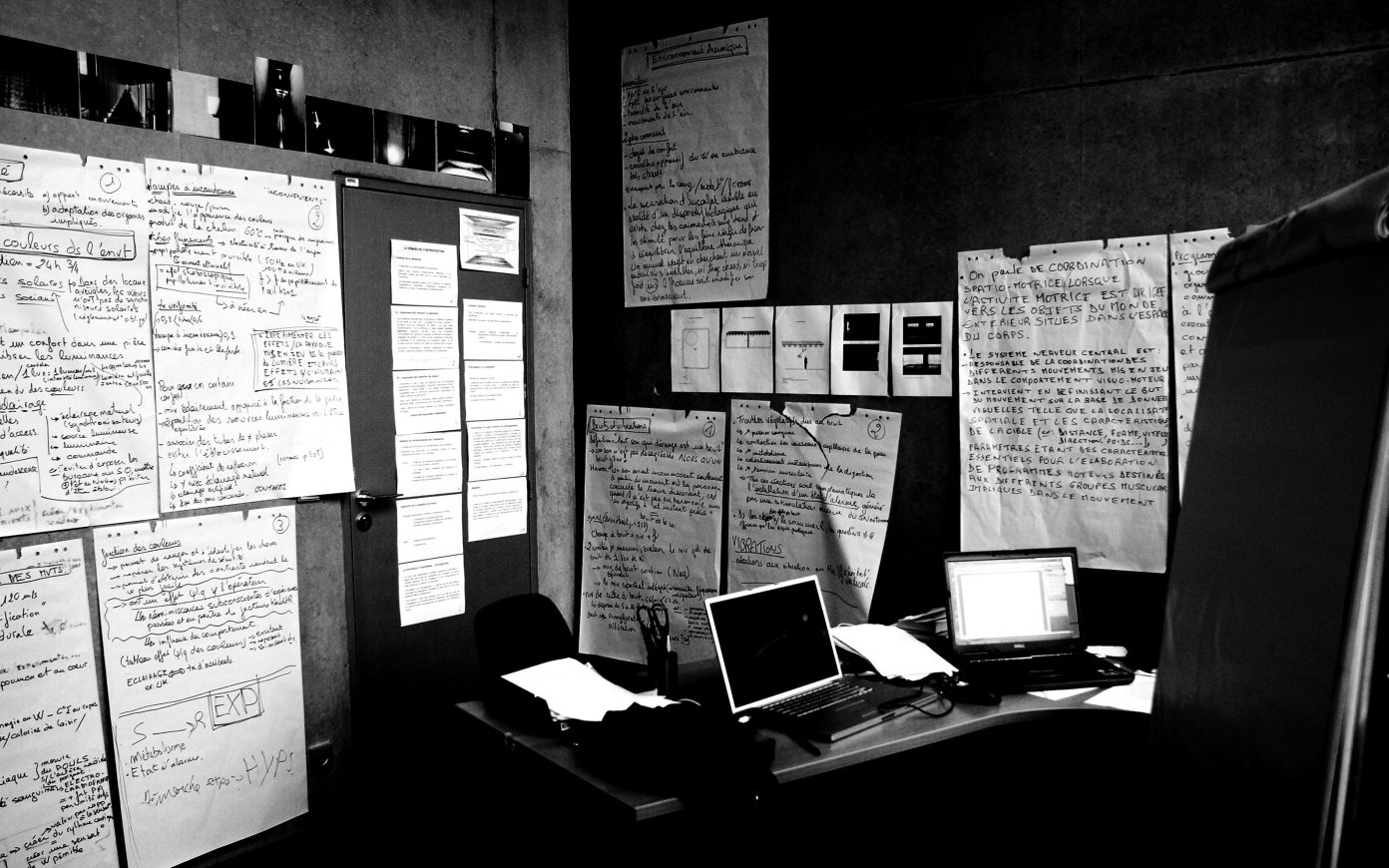L’Homme contre la nature
Vous êtes l’auteur de L’Univers sans l’homme, ouvrage dans lequel l’art, comme prisme de lecture, vous permet de battre en brèche – ou du moins de nuancer – l’acception dominante d’un rapport anthropocentré de l’homme au monde depuis la Renaissance. Quel a été le point de départ de cette recherche ?
Le point de départ date de l’exposition de Pierre Huyghe au Centre Pompidou, en 2013, recommandée par mon ami Judicaël Lavrador. Dans un entretien, HuygheVoir son entretien avec Philippe Chiambaretta et Éric Troncy dans Stream 03 : Habiter l’Anthropocène, PCA éditions, Paris, 2013 déclare que les lectures de Bruno Latour ou de Quentin Meillassoux – qui s’efforce de penser un « monde sans l’homme » – l’ont non seulement intéressé mais ont été des confirmations de ses intuitions. Cela m’a considérablement intrigué ; s’en est suivi un deuxième déclic, presque au même moment : la relecture, dix ans après ma thèse de doctorat, du Salon de 1859 de Baudelaire, lorsque celui-ci parle d’« univers sans l’homme » et de « nature sans l’homme ». J’ai alors voulu retracer la généalogie de cette idée, ou plus exactement des représentations que les artistes s’en font.
Vous identifiez trois « moments », trois « drames » qui expliqueraient historiquement l’émergence des grands mouvements modernes. Comment ces ruptures s’expriment-elles artistiquement ?
En 1755, un tremblement de terre ravage Lisbonne et fait plusieurs dizaines de milliers de victimes en deux jours. Cet horrible événement est l’objet d’une interprétation conflictuelle : d’un côté, la lecture providentialiste classique – tenue par l’Église – parle d’un châtiment divin, salutaire pour les hommes ; de l’autre, une vision rationnelle et éclairée, portée notamment par Voltaire et Kant, déplore un drame issu d’une contingence, où la nature n’est pas mue par Dieu pour punir les hommes, mais se meut en mécanique indifférente au sort de ceux-ci. La deuxième partie du XVIIIe siècle va voir s’amplifier des scènes de catastrophes à l’état pur, donnant naissance à une eschatologie que l’on pourrait qualifier de matérialiste – dans le Werther de Goethe, Le Dernier homme de Mary Shelley ou dans les écrits de Saint-Simon, entre autres exemples. C’est là que se profile une terreur moderne : la fin de l’espèce sans la fin de l’espace. C’en est terminé de la coïncidence entre disparition de l’Homme et dissipation de l’Histoire. L’Homme pourrait n’être plus là, et pourtant, l’Histoire continuerait… Ce que je montre dans la première partie du livre, c’est que parallèlement à cette vision anthropocritique, il y a de surcroît une promotion des sphères annexes – les animaux, les végétaux et même les « choses », si l’on songe entre autres aux Barbizoniens, à Rosa Bonheur, à Victor Hugo ou Jules Michelet – qui participe elle aussi au nivellement de la place de l’Homme à l’échelle du vivant.
C’est alors qu’en 1860, dans le prolongement du succès – éminemment scandaleux – de Darwin et de son essai sur l’origine des espèces, apparaît le raccourci mental qui désigne l’Homme comme descendant du singe. Ce traumatisme des origines brise définitivement la représentation figée et insécable de l’Humanité, réduite alors à une instance inconstante et provisoire. Je pense qu’on doit considérer les esthétiques de l’hybridation et les spéculations biologiques, physiques et mécaniques du Symbolisme ou du Futurisme comme des amplifications, inquiètes ou exaltées, imprégnées de ce nouveau paradigme.
Août 1945 sonne évidemment un troisième choc. Einstein lui-même déclare que, par l’arme atomique, se profile le risque de l’anéantissement de l’Humanité. Les artistes vont donner de nombreuses formes plastiques, littéraires ou cinématographiques, souvent très anxiogènes – je pense en particulier au Dernier Rivage, l’excellent film de Stanley Kramer (d’après un roman de Nevil Shute), en 1959 – à cette potentielle éradication. La fragilité de l’Humanité devient non seulement un motif, mais je dirais aussi une cause artistique. Et ce n’est plus la violence aveugle de la nature contre l’Homme qui est désormais le problème, mais la chaîne de conséquences incertaines émanant de l’action tellurique de l’Homme contre la nature, devenue une nature souffrante. D’où le paradoxe fascinant et très stimulant pour les artistes de la scène contemporaine : « l’abîme Anthropocène, où l’anthropocentrisme parvenu à sa pleine vigueur, atteint précisément ce point-limite après lequel a lieu l’Apocalypse. »