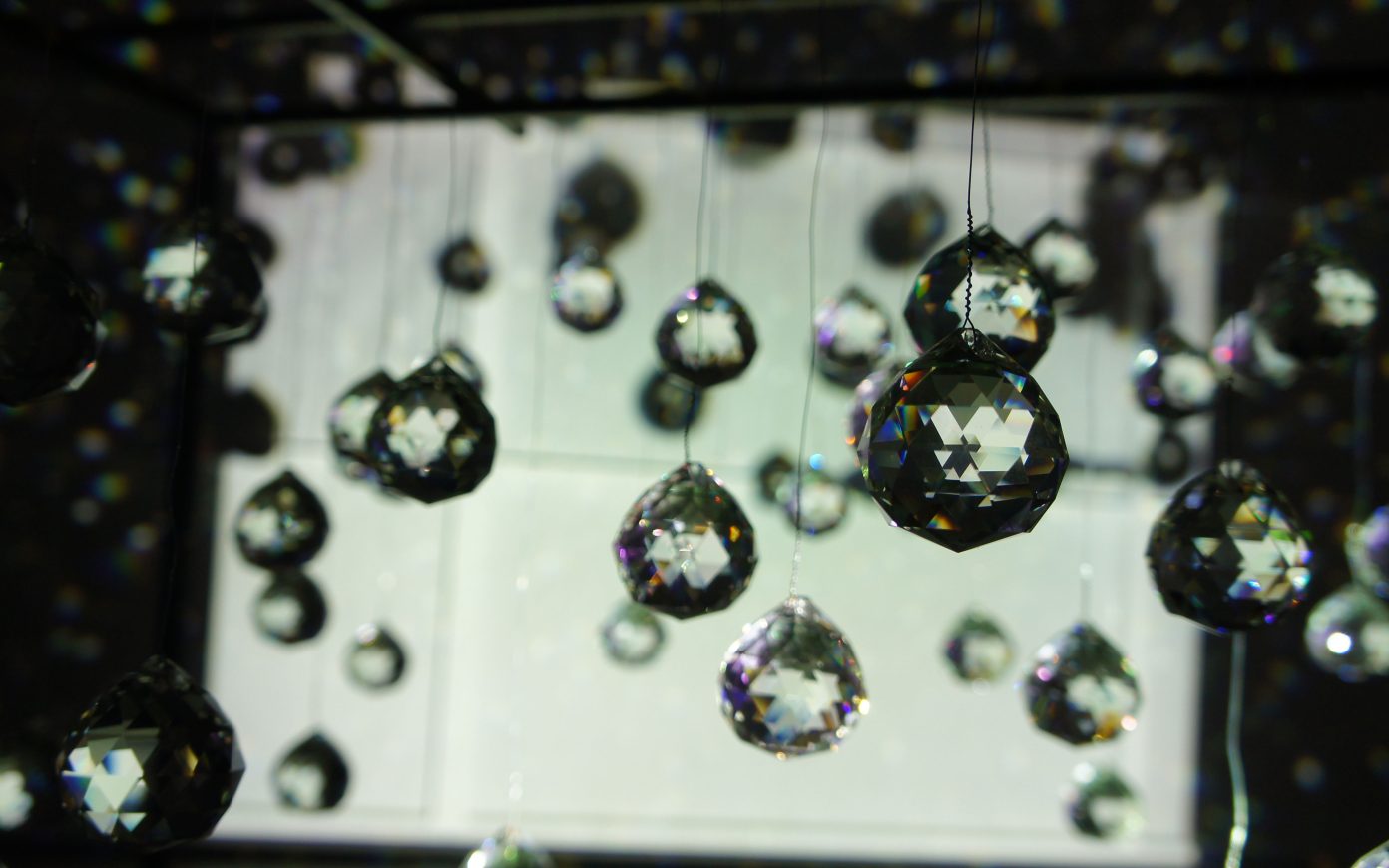L’argument qui consiste à analyser l’appropriation artistique de l’objet sous l’angle de l’expropriation de ceux qui l’ont conçu dans leur cadre de travail se voit employé, à la même époque, par Joseph Beuys, au sujet de l’urinoir de Marcel Duchamp : l’ouvrier qui a extrait le kaolin servant à le fabriquer est tout autant un « créateur » que celui qui vient le signer et l’exposer. Tous deux pratiquent une « mise en forme » (gestaltung) qui « agit sur tous les champs de force de la société et tous les contextes de travailJoseph Beuys, Par la présente, je n’appartiens pas à l’art, L’Arche, Paris, 1988, p. 59.». Charlier comme Beuys insistent sur le devoir qu’aurait l’artiste de ne pas dissimuler le processus de production, de ne pas isoler esthétiquement l’objet, ou, en d’autres termes, de se considérer comme placé au milieu d’un système productif élargi, et non pas au-dessus de celui-ci.
Des moyens objectifs et de l’utile
Trente ans plus tard, en 1993, Maurizio Cattelan montre à la Biennale de Venise une œuvre intitulée Lavorare e un brutto mestiere (« Travailler est un sale métier ») : il loue l’espace dont il dispose pour présenter son travail à une agence de communication, qui l’utilise à son tour pour une campagne publicitaire. Le geste de Cattelan montre comment la relation de l’artiste au monde du travail a changé du tout au tout : il ou elle est un « professionnel » parmi d’autres, qui peut faire appel à différents corps de métiers, et qui a abandonné toute prétention symbolique à révéler la structure productive, au profit d’un réalisme (qui confine parfois au cynisme) et d’une volonté d’insertion de son travail dans le flux ordinaire de la production. Autrement dit, le monde du travail ne constitue plus un référent symbolique pour la pratique artistique ; il forme son substrat quotidien. En l’occurrence, Cattelan dépeint l’artiste comme locataire d’un espace d’exposition qui peut se voir sous-loué…
Alighiero Boetti n’avait-il pas, dès le début des années 1970, délocalisé la production de ses tapis en Afghanistan, puis au Pakistan ?
Les rapports existant entre l’artiste et le mode du travail constituent la structure même de l’évolution artistique : en d’autres termes, l’art a toujours été « informé » par le monde du travail. La modernité artistique de la fin du xix e siècle apparaît au moment où ce rapport nécessite d’être problématisé picturalement, l’art apparaissant désormais aiguillonné par la concurrence de la photographie, comme un simple supplément, voire comme une activité socialement inutile. C’est à partir de ce fait que l’on peut comprendre le projet des peintres modernistes, du Polonais Wladyslaw Strzeminski (1893–1952) à l’Américain Frank Stella, qui chercheront dans leur pratique picturale les « moyens objectifs » leur permettant de transférer de la matière colorée du tube jusqu’à la toile : « objectifs », c’est-à-dire conformes à une logique productive indexée sur la production générale, c’est-à-dire contemporaine du système économique dans lequel ils vivent. L’art, à partir de la seconde moitié du xix e siècle, se doit de problématiser son rapport à la production sociale : soit en assumant « l’art pour l’art », c’est-à-dire en donnant un sens à l’inutile, soit en se raccordant au système productif d’une manière ou d’une autre. À un pôle de ce paysage, Andy Warhol fait corps avec l’univers de l’usine en s’identifiant ouvertement à une « machine » ou une « caméra ». Au pôle opposé, Robert Filliou se veut citoyen d’une « République géniale » composée de « génies de bistrots » oisifs et méditatifs. Quelle que soit la position prise par les artistes, opposition frontale ou relation mimétique, celle-ci provient de cette équation qui date des débuts de la modernité : l’art, refoulé du corps social ou menacé de l’être, ne constitue plus qu’un appendice de la société, un supplément plus ou moins légitime du système productif. Assumant son caractère ornemental ou improductif, l’art tentera de se valoriser comme l’oxygène d’un système asphyxié et réifié ; prétendant à l’utilité sociale, à son appartenance à une ontologie de la démocratie, il essaiera plutôt d’imposer les principes de sa nécessité en se tenant au plus près des processus de production.
Du travail, l’on peut dire assurément qu’il découpe et morcelle la réalité. La nature est tout d’abord asservie à des fins productives, puis le travail humain lui-même, tout d’abord sous forme de produits (le commerce), enfin comme activité et somme d’informations. Travailler, c’est segmenter la réalité à l’infini. L’on peut également affirmer qu’il est toujours subordonné à une fin, ou qu’il s’organise en vue d’un état final. Parmi les tentatives les plus remarquables de penser la sphère de l’inutile, la « part maudite » des activités humaines, celle de Georges Bataille s’avère d’autant plus actuelle qu’elle identifie clairement un immense domaine de la réalité qui n’avait jusqu’alors jamais été pensé en tant que tel : il invente l’hétérologie, « science de ce qui est tout autre », dans le cadre d’une déclaration de guerre philosophique à l’idéalisme sous toutes ses formes. Si elle ne prend pas en compte l’ordure et le gaspillage, l’extase religieuse et la jouissance érotique, les larmes et les flux corporels, toute pensée est marquée d’idéalisme. Dans la pensée de Bataille, le ludique, comme l’érotisme, le mysticisme et l’art, sont également rattachés à la sphère de la dépense somptuaire, au registre de cette hétérologie dont relève tout ce qui n’appartient pas à la « sphère de l’utile ». L’activité humaine n’a pas forcément un quelconque « gain » pour horizon, elle peut refuser de s’asservir à une fin prévue : le principe premier de l’économie, pour Bataille, n’est pas l’accumulation de biens, mais le potlatch, au cours duquel les tribus d’Amérique du nord rivalisaient dans la destruction de leurs biens les plus luxueux. Telle est la « part maudite » de l’économie humaine : cette pratique de la « perte » qui s’avère irréductible au binôme production/consommation et touche à l’irrationnel et à la mise en jeu existentielle, dans laquelle Bataille inclut « le luxe, les deuils, les guerres, les cultes, les constructions de monuments somptuaires, les jeux, les spectacles, les arts, l’activité sexuelle perverse (détournée de la finalité génitale)Georges Bataille, « La notion de dépense », in La part maudite, Les Éditions de Minuit, 2007, p.27.» …
La modernité artistique, depuis le milieu du xix e siècle, s’est ainsi construite autour d’un objet central : l’utile. Pour l’essentiel, en s’opposant à ses diktats, en luttant pour préserver une zone poétique à l’intérieur de la sphère utilitaire ; mais parfois aussi en s’identifiant à ses formes et ses principes, par exemple quand le Bauhaus ou le Constructivisme russe élaborèrent la théorie d’un art intégré au productivisme général, visant à imprégner durablement le décor du quotidien. Toujours est-il que la présence de l’art dans une société donnée, sa reconnaissance par les appareils idéologiques et institutionnels dont celle-ci s’est dotée, dépend des inflexions locales de cette problématique de l’utile, qui trace une ligne de démarcation entre le produit, utilisable, et le déchet, qui doit être rejeté et tenu à l’écart. Cette ligne invisible, mais active à tous les niveaux de l’organisation sociale, dessine les contours d’une zone mouvante dont la frontière se voit sans cesse franchie dans les deux sens : catégorie temporaire, et surtout largement arbitraire, celle du rebut est sujette à d’infinies renégociations. Dans le domaine de la production culturelle, nous l’avons vu, c’est sur le tracé de cette ligne de répartition que vient s’installer le camp des cultural studies, tel un sas entre les deux territoires du fonctionnel et du dérisoire, unité de recyclage venant obstinément questionner la validité des jugements expédiant tel ou tel objet dans la fosse. La problématique du déchet est devenue si centrale dans la vie socio-économique qu’une science récente entend même s’y consacrer : la rudologie. Du latin rudus (« décombres »), elle considère le déchet comme un objet d’analyse permettant d’appréhender la sphère économique et les pratiques sociales, s’attachant aux processus de dévalorisation des produits générés par l’activité humaine, ainsi qu’à ses techniques de retraitement. La rudologie approche ainsi la société à partir de ses traces marginales, rejoignant ainsi la méthode avec laquelle Georges Bataille explore les profondeurs de la psychologie collective, comme celle de Walter Benjamin s’essayant à reconstituer la cathédrale idéologique du xix e siècle à l’aide de fragments épars collectés dans les passages parisiens.
Parmi les mouvements artistiques du xx e siècle, du moins avant l’Internationale Situationniste, le Surréalisme est sans doute celui dont le projet esthétique s’est élevé avec le plus de virulence contre le règne de l’utile. L’œuvre surréaliste, mais ce terme même sentait pour eux le labeur et l’argent, se présente ainsi comme un résidu de l’activité onirique, c’est-à-dire d’un régime de l’esprit réfractaire à toute récupération sociale. L’irrationnel surréaliste constituait une déclaration de guerre au monde pratique, à la Raison coupable d’appartenir au camp de la besogne et de l’industrieux. En cela, le mouvement conduit par André Breton signale sa dette envers le Dadaïsme, mais il l’augmente d’une iconographie nostalgique, délibérément tournée vers les décombres du passé, qui se voyait nourrie par de fréquentes promenades dans les marchés aux puces des portes de Paris : l’obsolète apparaît ainsi comme le principal ferment du merveilleux surréaliste, ce que n’a pas manqué de pointer Walter Benjamin, qui relève l’intérêt des membres de ce mouvement pour les formes iconographiques les plus désuètes.
Le grand projet du Nouveau Réalisme fut la constitution d’une archéologie du présent, à travers les aventures de la production de masse et son usage social. Le travail de Jacques Villeglé, « comédie urbaine » qui retrace l’histoire de France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, telle que relatée par le « lacéré anonyme », apparaît ici comme emblématique. Benjamin Buchloh voyait ainsi dans les travaux de Raymond Hains, Jacques Villeglé et Mimmo Rotella une remise en question radicale de la figure de l’artiste par le groupe-sujet social. Villeglé représente pour le critique américain l’introducteur d’une attitude entièrement nouvelle : « En niant consciemment son rôle traditionnel, il cède la place au geste collectif de productivité qui, dans le contexte historique de Villeglé, était celui d’une agression muette contre l’état d’aliénation imposéeBenjamin Buchloh, Essais historiques II, Art édition, Lyon, 1992, p. 44.». Cette notion de « production anonyme », poursuit Buchloh, a ouvert la voie aux démarches de Stanley Brouwn, de Marcel Broodthaers ou de Bernd et Hilla Becher. La notion d’auteur une fois anéantie, l’artiste devient un collecteur, un associé objectif de la production collective. De cette problématique, on peut dire qu’elle est plus que jamais présente aujourd’hui : la plupart des artistes se présentent comme les compilateurs, les analystes ou les remixeurs de la culture de masse ou de la production médiatico-industrielle. S’ils ne partagent pas le style formel du Nouveau Réalisme, des artistes comme Mike Kelley, Jeremy Deller ou Sam Durant s’inscrivent dans les traces de Raymond Hains et Jacques Villeglé, et prêtent leur silhouette d’artiste au mythique « chiffonnier » décrit par Baudelaire : « tout ce que la grande cité a rejeté, tout ce qu’elle a perdu, tout ce qu’elle a dédaigné, tout ce qu’elle a brisé, il le catalogue, il le collectionne. Il compulse les archives de la débauche, le capharnaüm des rebuts“Du Vin et du Haschish”, in Walter Benjamin, Charles Baudelaire, Payot, Paris, p. 117. ».