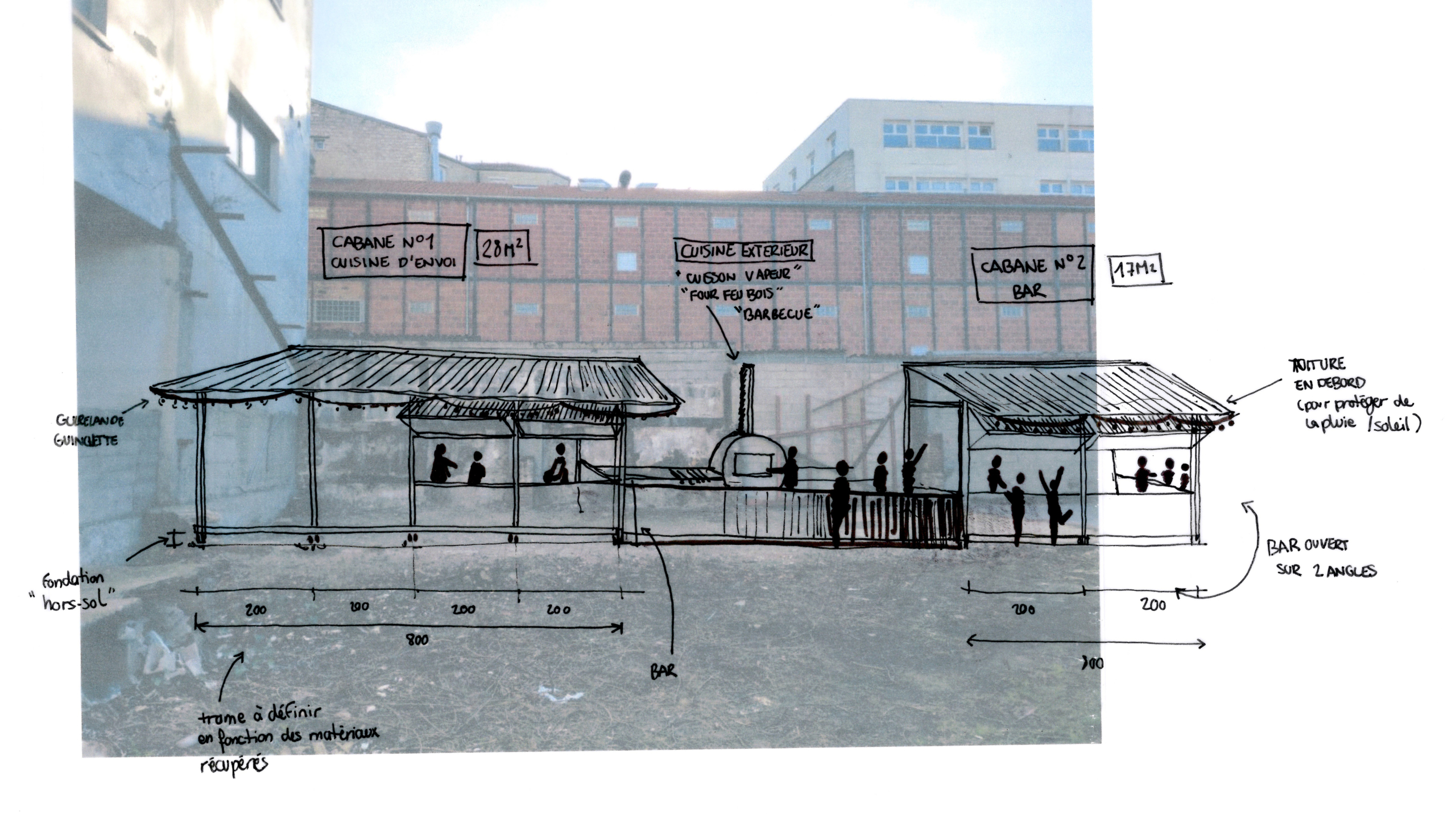Outre l’évolution des mentalités qui s’impose, existe-t-il quelque aspect matériel de la ville féministe, quelque amélioration urbaine que nous pourrions entreprendre de mettre en place ?
Il faut combiner ce que nous pourrions appeler des « interventions spatiales urbaines » et des interventions sociales. J’ai mentionné la création d’une sorte de filet de protection sociale permettant aux femmes et à d’autres personnes vulnérables de bénéficier d’un certain degré d’indépendance économique et de stabilité et ainsi éviter qu’elles se mettent en danger. C’est quelque chose de crucial, mais nous pouvons également imaginer toute une série de choses parfaitement évidentes au niveau des villes elles-mêmes, par exemple le fait d’améliorer l’éclairage public et les espaces de circulation, d’aboutir à des espaces où, pour reprendre l’expression célèbre de Jane Jacobs, il y a des « yeux fixés sur la rue », où il existe une communauté, une vie publique animée à différents moments de la journée, où les gens peuvent regarder à travers leurs fenêtres et voir ce qui se passe dans le voisinage, où les habitants se connaissent entre eux, ce qui signifie qu’il n’y a alors plus de lieux délaissés et vides… Les gens craignent souvent les personnes sans domicile fixe, mais la solution à cette question ne consiste pas à les écarter de la ville, mais plutôt de leur donner un domicile afin qu’ils ne soient plus contraints de vivre dans la rue et s’adonner à des activités susceptibles de susciter la peur. Il faut une approche conjuguant à la fois la mise en place d’un bon filet de protection sociale et celle d’un environnement urbain qui soit ouvert et accueillant pour autant de personnes que possible.
L’amélioration de l’éclairage constitue un bon exemple d’approche globale : au niveau le plus élémentaire, cela semble aller à rebours d’une logique écologique d’économies d’énergie, mais nous devons examiner cela dans le contexte plus large des sortes de voisinages que nous créons. Nul besoin de prévoir partout une saturation d’éclairages puissants lorsque nous sommes en présence de lieux à usages mixtes avec des rues où l’on trouve des cafés, des magasins, du transport public et ainsi de suite : une telle configuration sera ressentie comme plus sûre qu’une rue bien éclairée mais abandonnée. Être seul constitue le plus grand facteur de peur. Nous devons repenser la manière dont les villes ont été conçues de manière à dissocier le travail ayant lieu dans une zone donnée, l’habitat dans une autre zone, l’industrie ou le commerce dans une autre encore. Dans les zones comptant plus d’usages mixtes, des personnes circulent ici et là à toute heure et chacun se sent en sécurité du fait de cette présence. La maire de Paris, Anne Hidalgo a introduit le concept de la « ville du quart d’heure » et c’est un concept qui renvoie assurément aux idées féministes sur le fait de rapprocher ces choses pour rassembler et créer plus de proximité aux services, et ainsi également alléger la tâche de travail du care. Au moins, tant que nous répondons à la question de savoir qui a les moyens de vivre dans ces voisinages des quinze minutes.
Il en va de même des « technologies intelligentes ». Dans certains cas, des femmes mettent à profit des technologies telles que des applications mobiles pour procéder au repérage de lieux de harcèlement et d’insécurité par exemple. Cela peut s’avérer utile, mais dans beaucoup de cas nous savons qu’à l’image de la ville, ces technologies ne sont pas neutres. Elles sont en effet conçues par des personnes ayant des profils particuliers et ne servent pas nécessairement les besoins de la majorité des utilisatrices. Il existe d’ailleurs toujours une fracture technologique concernant l’accès aux smartphones ou aux ordinateurs à domicile. Tout le monde n’a pas accès à ces choses et il peut de ce fait y avoir des biais dans les données qui sont collectées et exploitées.
Les villes ont pour grand avantage de compter généralement tellement de communautés et de voisinages différents qu’elles génèrent depuis longtemps leurs propres idées sur ce dont elles ont besoin et ce qui fonctionne pour elles. Je me prends à imaginer que nous pourrions prêter attention à ces communautés et écouter ce dont elles auraient vraiment besoin. Ces dernières décennies, beaucoup de villes ont eu pour objectif d’utiliser l’espace urbain pour générer autant d’accumulation de capital que possible. Il s’agit donc également de procéder à un véritable changement des mentalités, passant du fait de penser les villes commes des machines à générer du profit pour les envisager dans leur viabilité.
À de nombreux égards, l’implication des habitants joue un rôle crucial dans l’approche genrée et inclusive que vous décrivez. Pensez-vous qu’elle puisse inspirer une évolution et un passage d’un urbanisme « par le haut » à une approche partant des populations ?
Il est en effet crucial de partir de la base. C’est un défi parce que cela prend plus de temps aux urbanistes et aux aménageurs de se concerter avec les habitants, de réellement les écouter, de trouver des moyens d’impliquer une grande diversité de membres de la communauté qui pourraient ne pas se sentir concernés par des réunions de planification, ou qui ne pensent pas qu’ils puissent faire entendre leur voix aux personnes au pouvoir. C’est donc un processus plus lent. Il n’est pas toujours facile de donner aux communautés tout ce qu’elles souhaitent, mais, comme on me l’a un jour fait remarquer, cela fait en réalité gagner du temps et de l’argent sur le long terme parce que si vous concevez un espace que personne ne souhaite utiliser, ou qui est insalubre, ou qui devient un repaire d’activités illicites, ou qui n’est pas durable d’une manière ou d’une autre. Il faudra en effet alors reconstruire ces espaces, ce qui beaucoup plus onéreux que de simplement prendre le temps dès le départ pour créer la sorte de logements, ou de terrains de jeu, ou d’espaces verts, ou de voies de communication qui puissent réellement répondre aux besoins des habitants de ces communautés.
Avec la pandémie, nous avons aussi pu constater que certaines communautés ont réellement pris les choses en main et mis en place ce que nous appelons des « pratiques d’aide mutuelle » : veillant à ce que chacun dispose d’assez à manger, s’occupant des personnes âgées et des enfants des autres lorsque cela peut être fait à moindre risque, véhiculant des voisins et d’autres actes de solidarité locale. Cela fait longtemps que les communautés élaborent leurs propres réseaux de care. Je pense que si nous commençons à y prêter attention et à rechercher l’existant, nous en apprendrons beaucoup sur la manière dont nous pourrions faire que cela puisse avoir lieu à plus grande échelle et sur ce que nos villes doivent faire pour mieux répondre aux besoins des personnes vulnérables dans nos villes. Il s’agit donc tout simplement de décider si cela constitue une priorité pour nos sociétés.